Contact & Rendez-vous: Tél. +49 160 9623 2547

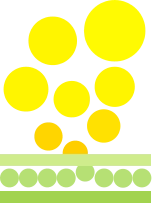
Que dit la science sur l'hypersensibilité ? Pour la troisième année consécutive, des
spécialistes scientifiques parmi les plus connus se sont retrouvés pour présenter l’état
actuel de la recherche sur la sensibilité. Après deux premières éditions purement
virtuelles, la troisième conférence internationale s'est tenue en présentiel à l'Université du
Surrey en Angleterre, le 23 mai 2025, avec retransmission en ligne. La rencontre était
animée par Michael Pluess, qui a récemment quitté l'université Queen Mary de Londres
pour rejoindre l'université du Surrey.
Après une première présentation d’ouverture, les intervenants suivants ont présenté
différentes recherches récentes ou en cours, suivis d'un débat sur les liens entre
l'hypersensibilité et la santé mentale.
Terminologie : il est question ici à la fois d'hypersensibilité (HSP = personnes
hypersensibles) et de sensibilité au traitement sensoriel (sensory processing sensitivity
= SPS). Les deux termes ont la même signification, mais SPS est plus scientifique. Le
terme de sensibilité environnementale est également de plus en plus utilisé par les
chercheurs. Dans ce qui suit, les trois termes sont interchangeables.
Ce qui suit sont les notes d'un participant en ligne et ne prétend à être ni exhaustif, ni
exempt d’erreurs.
Contenu de la 1ère partie
• Neurologie de l'hypersensibilité – recherche sur l’humain et l'animal • Hypersensibilité et drogues – une expérience animale • Sensibilité environnementale relativement aux émotions positives, à l’attachement à la nature et à l’angoisse climatique • Hypersensibilité et digestion • Hypersensibilité chez les écoliers • Sensibilité environnementale chez les enfants réfugiés syriens • Influence de l'irritabilité infantile sur l'effet des mesures éducatives parentales • Cliquez ici pour accéder à la partie 2Présentation en ouverture : Neurologie de l'hypersensibilité
– Recherche sur l'humain et l'animal
Prof. Judith Homberg du Centre médical universitaire Radboud aux Pays-Bas faisait la présentation d’ouverture. Dans ses travaux, elle tente de comprendre les cerveaux hypersensibles chez l'humain et chez l'animal à l'aide des outils de la recherche sur le cerveau. Que se passe-t-il réellement lorsqu'un nouveau stimulus sensoriel apparaît, par exemple un bruit ou un changement de température ? • Le stimulus se présente pour ainsi dire à la « réception ». Dans le cerveau, cela se passe dans le « réseau cérébral de la prépondérance » (« salience network »). Là, deux possibilités sont envisagées : • le stimulus peut-il être ignoré ou traité par les fonctions de base du cerveau ? Il est alors transmis au « réseau du mode par défaut » (« default mode network », principalement centré autour du cortex préfrontal dorso-médial). Le stimulus n'est pas perçu consciemment. • Une action est-elle nécessaire, par exemple parce qu'un danger pourrait approcher ? Dans ce cas, la réception transmet le stimulus au « réseau fronto-pariétal » (« central executive network »). Le stimulus est alors perçu consciemment. Entre autres, le cortex insulaire est chargé de l'intégration des stimuli sensoriels externes avec les émotions et les sentiments internes dans le cerveau. Quelques résultats d'études intéressants • Les personnes hypersensibles réagissent plus intensément aux images à contenu difficilement supportable, mais uniquement si elles ont eu une enfance heureuse ! • Chez les personnes ayant eu une enfance difficile, voire traumatisante, aucune différence n'est mesurable entre les personnes hypersensibles et les autres dans leur réaction à des images difficiles. • Lorsqu'on réalise un EEG (électroencéphalogramme), le cerveau des personnes hypersensibles reste plus actif que les autres - même au repos - mais uniquement lorsque les yeux sont ouverts. Une fois les yeux fermés, les EEG des deux groupes sont comparables. Prof. Homberg mène également de nombreuses recherches sur les animaux. Le hic est que les animaux ne peuvent pas remplir de questionnaires sur l'hypersensibilité. Ils ont donc développé un modèle qui détecte quatre signes d'hypersensibilité chez l’animal : • Réactivité émotionnelle accrue • Traitement plus profond des informations sensorielles • Une plus grande attention aux stimuli environnementaux • Tendance accrue à la surexcitation Des rats de laboratoire ont été envoyés dans un labyrinthe. Les rats présumés hypersensibles se sont distingués par les comportements suivants : • gel fréquent des mouvements, • nervosité accrue, • comportement plus inhibé. Hypersensibilité et drogues – une expérience animale L’hypersensibilité et la tendance à une forte excitabilité neurologique qui y est associée peuvent-elles conduire à une consommation accrue d'alcool et de drogues ? Une expérience a cherché à répondre à cette question. Des rats de laboratoire ont été soumis à un stress tout en ayant accès à une source de cocaïne à volonté. • Effectivement, les rats hypersensibles ont consommé nettement plus de cocaïne. • De plus, une différence a été constatée au niveau des neurotransmetteurs chez les rats hypersensibles : ils avaient plus de glutamate et moins de GABA que les rats normaux. Cela indique que l'hypersensibilité pourrait être liée à une diminution du nombre de neurones GABA, du moins chez les rats. • Autre fait intéressant : le cerveau d'un rat hypersensible réagit plus fortement à une même quantité de cocaïne que celui d'un rat normal. Il n'existe pour l'instant aucune explication à ce phénomène. On suppose que le cerveau des rats hypersensibles doit fournir comparativement plus d'efforts pour s’autoréguler et maintenir un équilibre entre activation et inhibition face aux stimuli environnementaux. Transposé à l'être humain, cela signifierait que • les personnes hypersensibles sont plus fortement activées par les stimuli sensoriels que les autres. Elles pourraient avoir moins de mécanismes d'inhibition pour atténuer et filtrer les stimuli. Elles disposeraient d'une marge plus réduite entre activation et inhibition pour s'autoréguler face aux stimuli sensoriels. • Pourquoi le seuil d'activation du « réseau fronto-pariétal » (« Central Executive Network ») semble-t-il plus bas ? Une raison possible : un excès du neurotransmetteur glutamate et un déficit de GABA. • Une activation plus intense par des stimuli provenant des mondes extérieur et intérieur a pour conséquence d’atteindre plus rapidement un trop-plein. Neurones activateurs vs. neurones inhibiteurs Il existe essentiellement deux types de neurones dans le cerveau : les neurones excitateurs (« excitatory neurons ») et les neurones inhibiteurs (« inhibiting neurons »). Ils fonctionnent un peu comme l'accélérateur et le frein d’un véhicule. La somme des effets activateurs et inhibiteurs crée un équilibre à un certain niveau. Dans le coma, par exemple, les neurones inhibiteurs sont très dominants. Dans un cerveau hypersensible, l'effet des neurones inhibiteurs peut être plus faible, tandis que celui des neurones activateurs est plus important. Au final, le niveau d’équilibre entre les deux est différent de celui observé chez les non-hypersensibles. Les personnes hypersensibles voient-elles et ressentent-elles davantage ? Une question revient souvent : les personnes hypersensibles voient-elles et ressentent- elles systématiquement plus fortement les stimuli sensoriels ? Ou bien le stimulus sensoriel est-il d'abord d’intensité similaire à l’arrivée, et seul son traitement interne est différent ? Le consensus actuel de la recherche est le suivant : • les personnes hypersensibles ne perçoivent pas les stimuli sensoriels de manière plus intense que les autres. • mais le traitement ultérieur de ces stimuli dispose peut-être de moins de filtres.L’hypersensibilité et ses liens aux émotions positives, à
l’attachement à la nature et à l'angoisse climatique
Dr Annalisa Setti, de l'University College de Cork (Irlande), mène des recherches sur la sensibilité au traitement sensoriel, les émotions positives et le rôle de l’attachement à la nature. Elle se pose la question centrale suivante : comment se construit en détail le lien avec la nature ? Et comment contribue-t-il à améliorer notre bien-être et nos capacités cognitives ? Voici quelques conclusions étayées par des données quantitatives et qualitatives : • Les personnes hypersensibles (HSP) ont en moyenne un lien plus fort avec la nature. • D'une part, les HSP ont plus souvent des comportements respectueux de l'environnement, mais d'autre part, elles sont également plus anxieuses face au changement climatique. Cela peut s'expliquer par le fait que les HSP ont davantage tendance aux ruminations. • Les personnes hypersensibles sont plus affectées dans leur bien-être que les autres lorsqu'elles se trouvent dans un environnement chaotique. Cependant, cet effet négatif est moins important lorsqu'elles ont un lien plus fort avec la nature. Il est intéressant de noter que cet effet positif est plus marqué chez les personnes âgées (plus de 60 ans) que chez les personnes d'âge moyen. • Les personnes hypersensibles réagissent plus positivement que les personnes normalement sensibles lorsqu'elles regardent une belle vidéo sur la nature. • Lorsque les personnes ont un faible lien à la nature, l’effet en est plus intensément négatif pour personnes hypersensibles. Cela confirme l'importance de la présence de la nature pour les personnes hypersensibles. Au cours de la brève séance de questions-réponses, il a été demandé si les personnes hypersensibles ont également tendance à s'engager davantage dans la lutte contre le changement climatique en raison de leur réaction plus intense à celui-ci. La réponse n'est pas connue. Cependant, toute forme d'activisme pose ses propres défis, face auxquels les hypersensibles sont peut-être plus réticents que les autres à s’engager.Hypersensibilité et digestion
Dr Shuhei Iimura de l'université Soka à Tokyo (Japon) a parlé des liens entre l'hypersensibilité et la digestion chez les adolescents. On sait depuis longtemps que les hypersensibles sont probablement plus vulnérables sur le plan psychologique. Ils semblent notamment plus sujets à l'anxiété et à la dépression. Mais qu'en est-il de la santé physique ? Depuis quelque temps déjà (Benham, 2006), on s'intéresse à un lien entre l'hypersensibilité et une plus forte fréquence de symptômes physiques divers, parmi lesquels les maux de dos, du ventre, de la tête, la diarrhée et les troubles du sommeil. Cependant, les études sur les symptômes physiques sont moins claires que celles sur les symptômes psychologiques. Il manque notamment une méta- étude. Le Dr Iimura a supervisé trois études sur la question et est parvenu aux conclusions suivantes : • Lorsqu'on interroge les personnes sur d'éventuels troubles digestifs éprouvés au cours des sept jours précédent l’entretien, les HSP rapportent plus souvent que les autres des reflux, des irritations gastriques, des douleurs abdominales, de la constipation et de la diarrhée. • Lorsque le microbiome est peu diversifié, l'hypersensibilité est corrélée à des marqueurs inflammatoires élevés (taux élevé de protéine C-réactive = CRP). Il se trouve que des marqueurs inflammatoires élevés sont souvent présents chez les personnes dépressives. • Les personnes hypersensibles présentent davantage de symptômes inflammatoires que les autres lorsque leur microbiome contient de faibles proportions de bactéries des genres Marinifilaceae et Butyricimonas. Il n'existe toutefois aucune indication que les hypersensibles aient une composition du microbiome fondamentalement différente des autres. L'importance du microbiome, notamment en lien avec la dépression, a été démontrée par des expériences étonnantes : des échantillons de selles ont été prélevés sur des personnes dépressives et transplantés à des souris en bonne santé. Les souris ont alors également présenté des symptômes de dépression ! Par ailleurs, les personnes autistes signalent plus souvent que les autres des troubles digestifs. La prise de certains compléments alimentaires peut vraisemblablement améliorer la santé mentale. Dans tous les cas, un système digestif sain améliore la santé générale des personnes hypersensibles, au plan tant physique que psychique.Hypersensibilité chez les écoliers
Dr Monika Baryła-Matejczuk (Université d'économie et d'innovation de Lubin, Pologne) a étudié des élèves de primaire des trois premières années dans cinq écoles du centre et de l'est de la Pologne. Les groupes ont également été contrôlés pour détecter différentes formes de neurodiversité afin d'éviter toute confusion entre l'hypersensibilité et d'autres traits de personnalité. Cette étude a confirmé de nombreuses caractéristiques connues ou présumées des enfants hypersensibles dans leur façon de vivre et de percevoir la vie : • Au niveau physique : perception accrue du corps, tendance à développer des symptômes physiques en cas de stress, sensation d'inconfort plus intense, réaction plus forte au bruit, à la lumière, aux textures et à un flux de stimuli, besoin d'un environnement structuré avec des pauses intégrées et pauvres en stimuli. Il est intéressant de noter qu'ils développent souvent d'eux-mêmes des stratégies pour mieux gérer l’afflux de stimuli. • Relations interpersonnelles : tendance à s’isoler ou former de très petits groupes. Ils observent les situations interpersonnelles pendant un certain temps avant d'y participer, ce qui leur donne souvent l'air timide ou renfermé. Ils sont engagés socialement, mais sélectifs dans le choix de leurs engagements. Ils ont tendance à s'investir pour les autres et préfèrent les relations authentiques. Ils recherchent souvent la reconnaissance des autres, ont tendance à vouloir plaire aux personnes d'autorité et sont sensibles à la critique et au rejet. • Domaine émotionnel : les émotions sont souvent contenues jusqu'à ce qu'elles deviennent trop fortes. Ils peuvent sembler calmes à l'extérieur, même si de nombreuses émotions se bousculent à l'intérieur. Ils recherchent la sécurité émotionnelle et la prévisibilité et peuvent devenir anxieux dans une situation nouvelle ou non structurée. Des attentes claires et des routines leur font du bien. Lorsque des réactions émotionnelles surviennent, elles sont rapides, parfois exagérées, et ils ont besoin d'aide pour se réguler. Pour l'autorégulation émotionnelle, un séjour dans la nature a un effet bénéfique et apaisant. Ces enfants font souvent preuve d'empathie envers les animaux et l'environnement. Ils peuvent réagir intensément aux sentiments et aux émotions des autres, se soucient souvent de leur bien-être et peuvent s'imprégner intensément d'une ambiance émotionnelle. • Cognition : les processus d'apprentissage sont abordés lentement. Les instructions étape par étape sont préférées. Capacités accrues de traitement approfondi de l'information, d'analyse et de pensée critique, sens accru de la justice et de l'éthique. Ils sont curieux, réfléchis, apprécient les défis intellectuels et trouvent des solutions créatives. Ils sont autocritiques, ont tendance au perfectionnisme et ont peur de l'échec. Dans le domaine artistique, on trouve souvent beaucoup de créativité et d'imagination dans la pensée et l'expression, et l'art peut être utilisé comme moyen de traiter les impressions et s'exprimer. Ces observations permettent de tirer des enseignements pour la prise en charge des enfants hypersensibles à l'école. Il serait notamment important que les enseignants soient informés et formés aux spécificités de l'hypersensibilité et à la manière de gérer ces enfants. Les enfants hypersensibles peuvent ainsi se sentir en sécurité et s'épanouir. Des adaptations sont souhaitables dans les domaines suivants : • environnement immédiat (salle de classe), • environnement élargi (école, structures, horaires, pauses, programmes scolaires, protocoles, soutien émotionnel pour les enfants et les enseignants...). Idéalement, une collaboration entre les enseignants et les parents devrait être mise en place afin de coordonner l'ensemble de la vie scolaire et privée.Sensibilité environnementale chez les enfants réfugiés
syriens
Dr Andrew May, de l'université du Surrey, a recherché des caractéristiques indiquant une sensibilité environnementale chez les enfants syriens réfugiés. Il est conscient qu'il existe encore de nombreuses inconnues dans les domaines suivants : • Quelle est la part génétique dans l’hypersensibilité ? • Comment la sensibilité environnementale est-elle « calibrée » pendant l'enfance ? 1.409 enfants âgés en moyenne de 11 ans ont été observés. 40 variables ont été prises en compte. La sensibilité des enfants a été évaluée à partir d'informations fournies par eux- mêmes. L'hypothèse était que les enfants hypersensibles réagissent plus fortement à un environnement négatif. Cette recherche s'inscrivait dans le cadre d'une étude plus large intitulée BIOPATH (Biological Pathways of Risk and Resilience Study). Résultats chez les enfants présentant une sensibilité environnementale accrue : • Les seuils de sensibilité plus bas chez les enfants sont corrélés à des expériences vécues de guerre, mais aussi à des troubles de stress post-traumatique chez la mère. • En outre, ils réagissent plus fortement que les autres enfants à un environnement particulièrement stressant, mais aussi, à l'inverse, à un environnement particulièrement favorable. D'autres études doivent notamment mettre en lumière les stratégies que ces enfants développent spontanément pour faire face à ces situations (« coping »). Lors de la discussion qui a suivi, Michael Pluess a ajouté qu'une étude montre que l'hypersensibilité est le facteur le plus significatif pour prédire une faible résilience. En d'autres termes, les personnes hypersensibles ont en moyenne moins de résilience que les autres.Influence de l'irritabilité infantile sur l'effet des mesures
éducatives parentales
Dans le cadre d'une étude en cours, Dr Danni Liu examine l'effet des mesures éducatives parentales de soutien et de punition (par exemple, les félicitations, la reconnaissance, les réprimandes, les punitions, l'éducation par l'exemple, etc.) sur des enfants présentant différents degrés d'irritabilité. A noter que l'irritabilité et la sensibilité sont deux choses différentes. Il est établi que les programmes éducatifs sont efficaces lorsqu'ils s'appuient sur les connaissances de la psychologie, en particulier pour traiter les comportements perturbateurs chez les jeunes enfants. Cela permet de remplacer les interventions coercitives réciproques, telles que décrites par Gerald Patterson, par des interventions plus fructueuses. Dans le cycle de Patterson, un comportement indésirable de l'enfant entraîne des punitions parentales, auxquelles l'enfant réagit par un comportement oppositionnel encore plus intense, ce qui conduit à un cercle vicieux qui s’intensifie. Ces cercles vicieux s'installent alors dans le système familial sous forme de processus automatiques récurrents. Au lieu de cela, les parents peuvent prendre des mesures non violentes qui renforcent et valorisent les comportements positifs de l'enfant afin d’en favoriser l'émergence en remplacement des comportements perturbateurs. L'exemple que donnent les parents dans leur façon de vivre et de faire a également un effet clair sur le comportement de l’enfant. L'hypothèse de l'étude actuelle est la suivante : • Les enfants hypersensibles pourraient mieux réagir aux programmes éducatifs si, en plus de leur hypersensibilité, ils sont également plus irritables que la moyenne. • Les enfants peu irritables devraient être moins réceptifs aux programmes éducatifs, car ils s'adaptent mieux au comportement de leurs parents. Les enfants moyennement irritables devraient être les moins réceptifs, car leur comportement est le plus difficile à modifier. Au moment de la présentation, aucun résultat définitif n'était encore disponible. A suivre: cliquez ici pour accéder à la seconde partie Lire aussi : • Sommet 2024 sur la recherche en matière d'hypersensibilité (disponible uniquement en alllemand) • Coaching pour hypersensibles • L'hypersensibilité au travail et dans le management • Le côté obscur de l'hypersensibilité • Autres articles et blogs • Déroulement d'une première séance de coaching • Contact et prise de rendez-vousAlexander Hohmann - le Blog
Le coaching, la vie et le reste
Courriel:
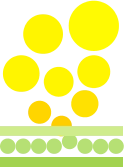
Que dit la science sur l'hypersensibilité ? Pour
la troisième année consécutive, des spécialistes
scientifiques parmi les plus connus se sont
retrouvés pour présenter l’état actuel de la
recherche sur la sensibilité. Après deux
premières éditions purement virtuelles, la
troisième conférence internationale s'est tenue
en présentiel à l'Université du Surrey en
Angleterre, le 23 mai 2025, avec retransmission
en ligne. La rencontre était animée par Michael
Pluess, qui a récemment quitté l'université
Queen Mary de Londres pour rejoindre
l'université du Surrey.
Après une première présentation d’ouverture,
les intervenants suivants ont présenté
différentes recherches récentes ou en cours,
suivis d'un débat sur les liens entre
l'hypersensibilité et la santé mentale.
Terminologie : il est question ici à la fois
d'hypersensibilité (HSP = personnes
hypersensibles) et de sensibilité au traitement
sensoriel (sensory processing sensitivity =
SPS). Les deux termes ont la même
signification, mais SPS est plus scientifique. Le
terme de sensibilité environnementale est
également de plus en plus utilisé par les
chercheurs. Dans ce qui suit, les trois termes
sont interchangeables.
Ce qui suit sont les notes d'un participant en
ligne et ne prétend à être ni exhaustif, ni exempt
d’erreurs.
Contenu de la 1ère partie
• Neurologie de l'hypersensibilité – recherche sur l’humain et l'animal • Hypersensibilité et drogues – une expérience animale • Sensibilité environnementale relativement aux émotions positives, à l’attachement à la nature et à l’angoisse climatique • Hypersensibilité et digestion • Hypersensibilité chez les écoliers • Sensibilité environnementale chez les enfants réfugiés syriens • Influence de l'irritabilité infantile sur l'effet des mesures éducatives parentales • Cliquez ici pour accéder à la partie 2Présentation en ouverture :
Neurologie de l'hypersensibilité
– Recherche sur l'humain et
l'animal
Prof. Judith Homberg du Centre médical universitaire Radboud aux Pays-Bas faisait la présentation d’ouverture. Dans ses travaux, elle tente de comprendre les cerveaux hypersensibles chez l'humain et chez l'animal à l'aide des outils de la recherche sur le cerveau. Que se passe-t-il réellement lorsqu'un nouveau stimulus sensoriel apparaît, par exemple un bruit ou un changement de température ? • Le stimulus se présente pour ainsi dire à la « réception ». Dans le cerveau, cela se passe dans le « réseau cérébral de la prépondérance » (« salience network »). Là, deux possibilités sont envisagées : • le stimulus peut-il être ignoré ou traité par les fonctions de base du cerveau ? Il est alors transmis au « réseau du mode par défaut » (« default mode network », principalement centré autour du cortex préfrontal dorso-médial). Le stimulus n'est pas perçu consciemment. • Une action est-elle nécessaire, par exemple parce qu'un danger pourrait approcher ? Dans ce cas, la réception transmet le stimulus au « réseau fronto-pariétal » (« central executive network »). Le stimulus est alors perçu consciemment. Entre autres, le cortex insulaire est chargé de l'intégration des stimuli sensoriels externes avec les émotions et les sentiments internes dans le cerveau. Quelques résultats d'études intéressants • Les personnes hypersensibles réagissent plus intensément aux images à contenu difficilement supportable, mais uniquement si elles ont eu une enfance heureuse ! • Chez les personnes ayant eu une enfance difficile, voire traumatisante, aucune différence n'est mesurable entre les personnes hypersensibles et les autres dans leur réaction à des images difficiles. • Lorsqu'on réalise un EEG (électroencéphalogramme), le cerveau des personnes hypersensibles reste plus actif que les autres - même au repos - mais uniquement lorsque les yeux sont ouverts. Une fois les yeux fermés, les EEG des deux groupes sont comparables. Prof. Homberg mène également de nombreuses recherches sur les animaux. Le hic est que les animaux ne peuvent pas remplir de questionnaires sur l'hypersensibilité. Ils ont donc développé un modèle qui détecte quatre signes d'hypersensibilité chez l’animal : • Réactivité émotionnelle accrue • Traitement plus profond des informations sensorielles • Une plus grande attention aux stimuli environnementaux • Tendance accrue à la surexcitation Des rats de laboratoire ont été envoyés dans un labyrinthe. Les rats présumés hypersensibles se sont distingués par les comportements suivants : • gel fréquent des mouvements, • nervosité accrue, • comportement plus inhibé. Hypersensibilité et drogues – une expérience animale L’hypersensibilité et la tendance à une forte excitabilité neurologique qui y est associée peuvent-elles conduire à une consommation accrue d'alcool et de drogues ? Une expérience a cherché à répondre à cette question. Des rats de laboratoire ont été soumis à un stress tout en ayant accès à une source de cocaïne à volonté. • Effectivement, les rats hypersensibles ont consommé nettement plus de cocaïne. • De plus, une différence a été constatée au niveau des neurotransmetteurs chez les rats hypersensibles : ils avaient plus de glutamate et moins de GABA que les rats normaux. Cela indique que l'hypersensibilité pourrait être liée à une diminution du nombre de neurones GABA, du moins chez les rats. • Autre fait intéressant : le cerveau d'un rat hypersensible réagit plus fortement à une même quantité de cocaïne que celui d'un rat normal. Il n'existe pour l'instant aucune explication à ce phénomène. On suppose que le cerveau des rats hypersensibles doit fournir comparativement plus d'efforts pour s’autoréguler et maintenir un équilibre entre activation et inhibition face aux stimuli environnementaux. Transposé à l'être humain, cela signifierait que • les personnes hypersensibles sont plus fortement activées par les stimuli sensoriels que les autres. Elles pourraient avoir moins de mécanismes d'inhibition pour atténuer et filtrer les stimuli. Elles disposeraient d'une marge plus réduite entre activation et inhibition pour s'autoréguler face aux stimuli sensoriels. • Pourquoi le seuil d'activation du « réseau fronto-pariétal » (« Central Executive Network ») semble-t-il plus bas ? Une raison possible : un excès du neurotransmetteur glutamate et un déficit de GABA. • Une activation plus intense par des stimuli provenant des mondes extérieur et intérieur a pour conséquence d’atteindre plus rapidement un trop-plein. Neurones activateurs vs. neurones inhibiteurs Il existe essentiellement deux types de neurones dans le cerveau : les neurones excitateurs (« excitatory neurons ») et les neurones inhibiteurs (« inhibiting neurons »). Ils fonctionnent un peu comme l'accélérateur et le frein d’un véhicule. La somme des effets activateurs et inhibiteurs crée un équilibre à un certain niveau. Dans le coma, par exemple, les neurones inhibiteurs sont très dominants. Dans un cerveau hypersensible, l'effet des neurones inhibiteurs peut être plus faible, tandis que celui des neurones activateurs est plus important. Au final, le niveau d’équilibre entre les deux est différent de celui observé chez les non- hypersensibles. Les personnes hypersensibles voient-elles et ressentent-elles davantage ? Une question revient souvent : les personnes hypersensibles voient-elles et ressentent-elles systématiquement plus fortement les stimuli sensoriels ? Ou bien le stimulus sensoriel est-il d'abord d’intensité similaire à l’arrivée, et seul son traitement interne est différent ? Le consensus actuel de la recherche est le suivant : • les personnes hypersensibles ne perçoivent pas les stimuli sensoriels de manière plus intense que les autres. • mais le traitement ultérieur de ces stimuli dispose peut-être de moins de filtres.L’hypersensibilité et ses liens
aux émotions positives, à
l’attachement à la nature et à
l'angoisse climatique
Dr Annalisa Setti, de l'University College de Cork (Irlande), mène des recherches sur la sensibilité au traitement sensoriel, les émotions positives et le rôle de l’attachement à la nature. Elle se pose la question centrale suivante : comment se construit en détail le lien avec la nature ? Et comment contribue-t-il à améliorer notre bien-être et nos capacités cognitives ? Voici quelques conclusions étayées par des données quantitatives et qualitatives : • Les personnes hypersensibles (HSP) ont en moyenne un lien plus fort avec la nature. • D'une part, les HSP ont plus souvent des comportements respectueux de l'environnement, mais d'autre part, elles sont également plus anxieuses face au changement climatique. Cela peut s'expliquer par le fait que les HSP ont davantage tendance aux ruminations. • Les personnes hypersensibles sont plus affectées dans leur bien-être que les autres lorsqu'elles se trouvent dans un environnement chaotique. Cependant, cet effet négatif est moins important lorsqu'elles ont un lien plus fort avec la nature. Il est intéressant de noter que cet effet positif est plus marqué chez les personnes âgées (plus de 60 ans) que chez les personnes d'âge moyen. • Les personnes hypersensibles réagissent plus positivement que les personnes normalement sensibles lorsqu'elles regardent une belle vidéo sur la nature. • Lorsque les personnes ont un faible lien à la nature, l’effet en est plus intensément négatif pour personnes hypersensibles. Cela confirme l'importance de la présence de la nature pour les personnes hypersensibles. Au cours de la brève séance de questions- réponses, il a été demandé si les personnes hypersensibles ont également tendance à s'engager davantage dans la lutte contre le changement climatique en raison de leur réaction plus intense à celui-ci. La réponse n'est pas connue. Cependant, toute forme d'activisme pose ses propres défis, face auxquels les hypersensibles sont peut-être plus réticents que les autres à s’engager.Hypersensibilité et digestion
Dr Shuhei Iimura de l'université Soka à Tokyo (Japon) a parlé des liens entre l'hypersensibilité et la digestion chez les adolescents. On sait depuis longtemps que les hypersensibles sont probablement plus vulnérables sur le plan psychologique. Ils semblent notamment plus sujets à l'anxiété et à la dépression. Mais qu'en est-il de la santé physique ? Depuis quelque temps déjà (Benham, 2006), on s'intéresse à un lien entre l'hypersensibilité et une plus forte fréquence de symptômes physiques divers, parmi lesquels les maux de dos, du ventre, de la tête, la diarrhée et les troubles du sommeil. Cependant, les études sur les symptômes physiques sont moins claires que celles sur les symptômes psychologiques. Il manque notamment une méta-étude. Le Dr Iimura a supervisé trois études sur la question et est parvenu aux conclusions suivantes : • Lorsqu'on interroge les personnes sur d'éventuels troubles digestifs éprouvés au cours des sept jours précédent l’entretien, les HSP rapportent plus souvent que les autres des reflux, des irritations gastriques, des douleurs abdominales, de la constipation et de la diarrhée. • Lorsque le microbiome est peu diversifié, l'hypersensibilité est corrélée à des marqueurs inflammatoires élevés (taux élevé de protéine C-réactive = CRP). Il se trouve que des marqueurs inflammatoires élevés sont souvent présents chez les personnes dépressives. • Les personnes hypersensibles présentent davantage de symptômes inflammatoires que les autres lorsque leur microbiome contient de faibles proportions de bactéries des genres Marinifilaceae et Butyricimonas. Il n'existe toutefois aucune indication que les hypersensibles aient une composition du microbiome fondamentalement différente des autres. L'importance du microbiome, notamment en lien avec la dépression, a été démontrée par des expériences étonnantes : des échantillons de selles ont été prélevés sur des personnes dépressives et transplantés à des souris en bonne santé. Les souris ont alors également présenté des symptômes de dépression ! Par ailleurs, les personnes autistes signalent plus souvent que les autres des troubles digestifs. La prise de certains compléments alimentaires peut vraisemblablement améliorer la santé mentale. Dans tous les cas, un système digestif sain améliore la santé générale des personnes hypersensibles, au plan tant physique que psychique.Hypersensibilité chez les
écoliers
Dr Monika Baryła-Matejczuk (Université d'économie et d'innovation de Lubin, Pologne) a étudié des élèves de primaire des trois premières années dans cinq écoles du centre et de l'est de la Pologne. Les groupes ont également été contrôlés pour détecter différentes formes de neurodiversité afin d'éviter toute confusion entre l'hypersensibilité et d'autres traits de personnalité. Cette étude a confirmé de nombreuses caractéristiques connues ou présumées des enfants hypersensibles dans leur façon de vivre et de percevoir la vie : • Au niveau physique : perception accrue du corps, tendance à développer des symptômes physiques en cas de stress, sensation d'inconfort plus intense, réaction plus forte au bruit, à la lumière, aux textures et à un flux de stimuli, besoin d'un environnement structuré avec des pauses intégrées et pauvres en stimuli. Il est intéressant de noter qu'ils développent souvent d'eux-mêmes des stratégies pour mieux gérer l’afflux de stimuli. • Relations interpersonnelles : tendance à s’isoler ou former de très petits groupes. Ils observent les situations interpersonnelles pendant un certain temps avant d'y participer, ce qui leur donne souvent l'air timide ou renfermé. Ils sont engagés socialement, mais sélectifs dans le choix de leurs engagements. Ils ont tendance à s'investir pour les autres et préfèrent les relations authentiques. Ils recherchent souvent la reconnaissance des autres, ont tendance à vouloir plaire aux personnes d'autorité et sont sensibles à la critique et au rejet. • Domaine émotionnel : les émotions sont souvent contenues jusqu'à ce qu'elles deviennent trop fortes. Ils peuvent sembler calmes à l'extérieur, même si de nombreuses émotions se bousculent à l'intérieur. Ils recherchent la sécurité émotionnelle et la prévisibilité et peuvent devenir anxieux dans une situation nouvelle ou non structurée. Des attentes claires et des routines leur font du bien. Lorsque des réactions émotionnelles surviennent, elles sont rapides, parfois exagérées, et ils ont besoin d'aide pour se réguler. Pour l'autorégulation émotionnelle, un séjour dans la nature a un effet bénéfique et apaisant. Ces enfants font souvent preuve d'empathie envers les animaux et l'environnement. Ils peuvent réagir intensément aux sentiments et aux émotions des autres, se soucient souvent de leur bien-être et peuvent s'imprégner intensément d'une ambiance émotionnelle. • Cognition : les processus d'apprentissage sont abordés lentement. Les instructions étape par étape sont préférées. Capacités accrues de traitement approfondi de l'information, d'analyse et de pensée critique, sens accru de la justice et de l'éthique. Ils sont curieux, réfléchis, apprécient les défis intellectuels et trouvent des solutions créatives. Ils sont autocritiques, ont tendance au perfectionnisme et ont peur de l'échec. Dans le domaine artistique, on trouve souvent beaucoup de créativité et d'imagination dans la pensée et l'expression, et l'art peut être utilisé comme moyen de traiter les impressions et s'exprimer. Ces observations permettent de tirer des enseignements pour la prise en charge des enfants hypersensibles à l'école. Il serait notamment important que les enseignants soient informés et formés aux spécificités de l'hypersensibilité et à la manière de gérer ces enfants. Les enfants hypersensibles peuvent ainsi se sentir en sécurité et s'épanouir. Des adaptations sont souhaitables dans les domaines suivants : • environnement immédiat (salle de classe), • environnement élargi (école, structures, horaires, pauses, programmes scolaires, protocoles, soutien émotionnel pour les enfants et les enseignants...). Idéalement, une collaboration entre les enseignants et les parents devrait être mise en place afin de coordonner l'ensemble de la vie scolaire et privée.Sensibilité environnementale
chez les enfants réfugiés
syriens
Dr Andrew May, de l'université du Surrey, a recherché des caractéristiques indiquant une sensibilité environnementale chez les enfants syriens réfugiés. Il est conscient qu'il existe encore de nombreuses inconnues dans les domaines suivants : • Quelle est la part génétique dans l’hypersensibilité ? • Comment la sensibilité environnementale est-elle « calibrée » pendant l'enfance ? 1.409 enfants âgés en moyenne de 11 ans ont été observés. 40 variables ont été prises en compte. La sensibilité des enfants a été évaluée à partir d'informations fournies par eux-mêmes. L'hypothèse était que les enfants hypersensibles réagissent plus fortement à un environnement négatif. Cette recherche s'inscrivait dans le cadre d'une étude plus large intitulée BIOPATH (Biological Pathways of Risk and Resilience Study). Résultats chez les enfants présentant une sensibilité environnementale accrue : • Les seuils de sensibilité plus bas chez les enfants sont corrélés à des expériences vécues de guerre, mais aussi à des troubles de stress post-traumatique chez la mère. • En outre, ils réagissent plus fortement que les autres enfants à un environnement particulièrement stressant, mais aussi, à l'inverse, à un environnement particulièrement favorable. D'autres études doivent notamment mettre en lumière les stratégies que ces enfants développent spontanément pour faire face à ces situations (« coping »). Lors de la discussion qui a suivi, Michael Pluess a ajouté qu'une étude montre que l'hypersensibilité est le facteur le plus significatif pour prédire une faible résilience. En d'autres termes, les personnes hypersensibles ont en moyenne moins de résilience que les autres.Influence de l'irritabilité
infantile sur l'effet des mesures
éducatives parentales
Dans le cadre d'une étude en cours, Dr Danni Liu examine l'effet des mesures éducatives parentales de soutien et de punition (par exemple, les félicitations, la reconnaissance, les réprimandes, les punitions, l'éducation par l'exemple, etc.) sur des enfants présentant différents degrés d'irritabilité. A noter que l'irritabilité et la sensibilité sont deux choses différentes. Il est établi que les programmes éducatifs sont efficaces lorsqu'ils s'appuient sur les connaissances de la psychologie, en particulier pour traiter les comportements perturbateurs chez les jeunes enfants. Cela permet de remplacer les interventions coercitives réciproques, telles que décrites par Gerald Patterson, par des interventions plus fructueuses. Dans le cycle de Patterson, un comportement indésirable de l'enfant entraîne des punitions parentales, auxquelles l'enfant réagit par un comportement oppositionnel encore plus intense, ce qui conduit à un cercle vicieux qui s’intensifie. Ces cercles vicieux s'installent alors dans le système familial sous forme de processus automatiques récurrents. Au lieu de cela, les parents peuvent prendre des mesures non violentes qui renforcent et valorisent les comportements positifs de l'enfant afin d’en favoriser l'émergence en remplacement des comportements perturbateurs. L'exemple que donnent les parents dans leur façon de vivre et de faire a également un effet clair sur le comportement de l’enfant. L'hypothèse de l'étude actuelle est la suivante : • Les enfants hypersensibles pourraient mieux réagir aux programmes éducatifs si, en plus de leur hypersensibilité, ils sont également plus irritables que la moyenne. • Les enfants peu irritables devraient être moins réceptifs aux programmes éducatifs, car ils s'adaptent mieux au comportement de leurs parents. Les enfants moyennement irritables devraient être les moins réceptifs, car leur comportement est le plus difficile à modifier. Au moment de la présentation, aucun résultat définitif n'était encore disponible. A suivre: cliquez ici pour accéder à la seconde partie Lire aussi : • Sommet 2024 sur la recherche en matière d'hypersensibilité (disponible uniquement en alllemand) • Coaching pour hypersensibles • L'hypersensibilité au travail et dans le management • Le côté obscur de l'hypersensibilité • Autres articles et blogs • Déroulement d'une première séance de coaching • Contact et prise de rendez-vousAlexander Hohmann
Le Blog
Le coaching, la vie et le reste

- Contact et prise de rendez-vous
- De nouvelles voies avec un coach
- Hypersensibilité
- Hypersensibilité en entreprise
- Haut potentiel intellectuel
- Petite biographie du coach
- Le "coaching systémique", qu'est-ce?
- Que disent les clients?
- Blog & Articles
- Podcasts, Vidéos, Médias
- Ressources & Liens
- Mentions légales
- RETOUR









