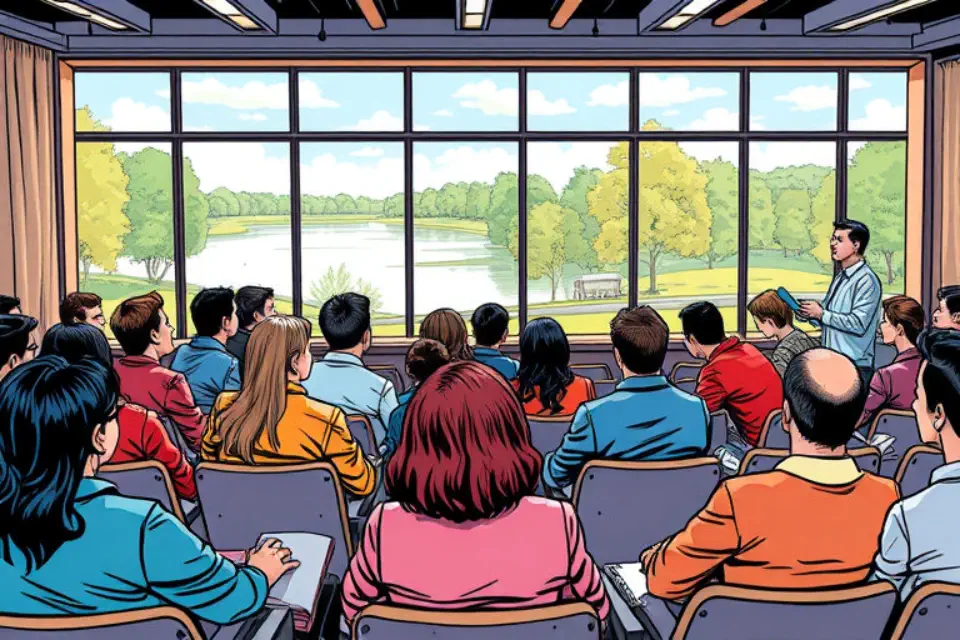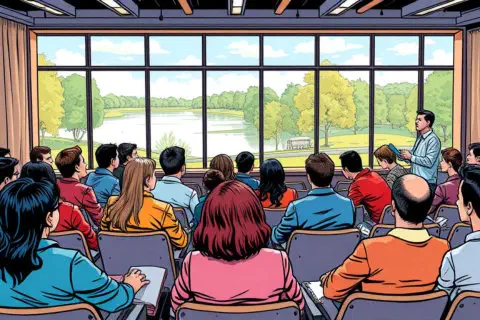Contact & Rendez-vous: Tél. +49 160 9623 2547

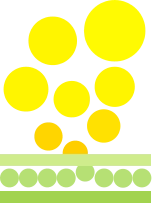
Contenu de la seconde partie
(Première partie : cliquez ici pour accéder à la partie 1) • Comment le repos et le sommeil agissent-ils sur la mémoire des personnes hypersensibles ? • Quels sont les facteurs qui permettent aux hypersensibles de trouver une meilleure qualité de vie ? • Influence de la solitude choisie ou subie sur le lien entre hypersensibilité et santé • Douleur et qualité de vie : hypersensibilité et sensibilisation centrale (HACS) chez les patients souffrant de douleurs chroniques • Le rôle de l’hypersensibilité dans la croissance post-traumatique et la gestion du stress • Discussion sur les liens entre hypersensibilité et santé mentale : questions et réponses sur les facteurs positifs et négatifs influant sur la santé mentale, prévention et hypersensibilité, les particularités de la psychothérapie avec des HSP, les liens avec d'autres formes de neurodiversité, l'acceptation culturelle, les différences entre les pays, etc.Comment le repos et le sommeil affectent-ils la mémoire des
personnes hypersensibles ?
Dr Robert Marhenke, de l'université d'Innsbruck, étudie l'influence du repos à l’état de veille et du sommeil sur la mémoire. Dans l’une des expérimentations, les participants ont été répartis en deux groupes. Pour commencer, les deux groupes devaient mémoriser deux listes de mots. • Un groupe a ensuite pu se reposer les yeux fermés pendant 8 minutes. • L'autre groupe devait accomplir pendant 8 minutes des tâches qui exigeaient une attention visuelle. • Une semaine plus tard, on leur a demandé de quels mots mémorisés ils se souvenaient. • Chez les non-hypersensibles, aucune différence n'a été constatée entre les deux groupes. • Parmi les hypersensibles, le groupe qui avait fait une pause de 8 minutes les yeux fermés se souvenait de nettement plus de mots que la moyenne, tandis que les hypersensibles de l'autre groupe se souvenaient de nettement moins de mots que la moyenne. • Cette différence chez les personnes hypersensibles n'est toutefois pas apparue lorsqu’elles étaient interrogées immédiatement après l'expérience, mais seulement lors d'un questionnaire réalisé plusieurs jours plus tard ! Il était également intéressant de noter que pendant la pause, les personnes hypersensibles présentaient des connexions plus denses dans les ondes cérébrales au sein du réseau du mode par défaut (« Default Mode Network ») et plus particulièrement entre l'hippocampe et le précuneus. Cela pourrait indiquer un mécanisme de « consolidation du système », dans lequel les souvenirs, qui se trouvent généralement dans l'hippocampe, sont transférés vers le néocortex pour être stockés à long terme. De tels mécanismes peuvent se produire dans un état de veille au calme, mais ils sont surtout typiques de la phase dite paradoxale du sommeil. Ils peuvent signifier une mémoire à long terme accrue – ou alors un traitement plus profond des expériences vécues. Une autre expérience menée avec des utilisateurs d'Instagram a comparé l'effet de 8 minutes de pause yeux fermés à 8 minutes de navigation sur Instagram. Ici, les utilisateurs d'Instagram hypersensibles ont montré les performances mémorielles les plus basses de tous lorsqu'on leur a demandé de se souvenir des mots 16 et 35 minutes après l'exercice. D'autres études semblent montrer que cette meilleure mémoire chez les personnes hypersensibles n'est efficace que si la pause est prise immédiatement après l'apprentissage. En revanche, aucune différence n'est constatée lorsque les pauses sont prises plus tard ou après avoir dormi. Il en ressort que les personnes hypersensibles ont une meilleure mémoire lorsqu'elles font une pause immédiatement après une nouvelle expérience, afin de l'assimiler. Si elles attendent, cet avantage disparaît.Quels sont les facteurs qui permettent aux personnes
hypersensibles d’atteindre une meilleure qualité de vie ? Un
état des lieux des connaissances pour plus de bien-être
Dr Becky Black de l'université de Melbourne et Dr Rohan Borschmann de l'université d'Oxford mènent une étude continue de la littérature spécialisée de 1990 à aujourd'hui. Ils recherchent tous les facteurs susceptibles d'améliorer le bien-être des personnes hypersensibles. Ces facteurs et stratégies ont probablement un effet positif sur tout le monde. Mais l’effet semble être plus intensément bénéfique sur les personnes hypersensibles. • Facteurs environnementaux : parents attentifs et encourageants, transitions bien vécues entre les étapes du parcours scolaire, environnement de travail favorable. • Lien à la nature : une immersion dans la nature réduit notamment les ruminations et améliore l'humeur. Même de courts séjours dans la nature ont un effet positif. Les forêts ont un effet positif plus marqué que les champs. • Stratégies psychologiques : pleine conscience, méditation, acceptation de soi, pensée positive, autorégulation émotionnelle – en particulier discuter consciemment des situations avec soi-même afin de les voir sous un autre angle, de les évaluer de manière plus rationnelle et de les relativiser («réévaluation cognitive» / «cognitive reappraisal»). • Réseau humain personnel et relations : échanger ses expériences avec d'autres hypersensibles apporte une validation ; le développement des compétences interpersonnelles est particulièrement important pour prévenir la dépression chez les jeunes ; un bon équilibre entre sociabilité et moments tout seuls ; le sentiment d'être soutenu par son entourage et sa famille. • Activités physiques : yoga et méditation, activité physique et sport réguliers, alimentation saine, routines et structures. • Stratégies d'adaptation : environnement calme, casques ou écouteurs à suppression de bruits, exprimer ses émotions, demander soutien et d'aide, résoudre les des problèmes et planifier, éviter des stimuli excessifs. • Développement personnel : connaissance de soi, en particulier connaissance de l'hypersensibilité, développer son intelligence émotionnelle, rechercher un sens et un but à la vie. • Aide professionnelle : psychothérapie de qualité avec des thérapeutes familiarisés avec l'hypersensibilité, interventions sur mesure (par exemple, les enfants hypersensibles réagissent mieux à une thérapie individuelle qu'à une thérapie de groupe), programmes visant à renforcer la résilience. • Profession et carrière : trouver une carrière qui correspond à l'hypersensibilité, dans un environnement qui permet l'autonomie et pratique des styles de management qui soutient les salariés. En conclusion, on constate l'importance à la fois d'un environnement adapté et des stratégies personnelles. Des recherches futures pourraient examiner l'effet spécifique de certaines interventions psychologiques ou thérapeutiques individuelles.Influence de la solitude choisie ou subie sur le lien entre
hypersensibilité et santé
Dr Grant Benham, de l'université du Texas dans la vallée du Rio Grande, étudie comment les défis dans les relations aux autres affectent la santé des personnes hypersensibles. Voici quelques exemples de ces défis : • déficits en matière de compétences interpersonnelles et communicatives, • phobie sociale, • relations superficielles, • absence de relations positives. (L'introversion ou la timidité ne sont pas ici considérées parmi ces défis.) Il faut garder à l'esprit qu'une faible sociabilité peut également être une stratégie librement choisie pour faire face à une trop forte réponse aux stimuli. Le Dr Benham a publié sa première étude sur le lien entre hypersensibilité et santé en 2006, qui portait alors sur les symptômes physiques. Depuis lors, différentes études ont été menées sur le lien entre l'hypersensibilité et les problèmes de santé tant physique que mentale. Les personnes hypersensibles ont une tendance plus marquée à passer volontairement du temps seules. Il convient toutefois de distinguer la solitude choisie (anglais : « solitude ») de la solitude subie (anglais : « loneliness »), cette dernière povant être perçue comme un stress. Le Dr Benham s'est notamment posé la question suivante : les personnes hypersensibles sont-elles plus souvent seules ? Ou le fait de choisir d'être seul réduit-il au contraire le sentiment de solitude ? Les résultats ont montré que les personnes hypersensibles ont effectivement plus souvent que les autres des sentiments de solitude, et que la tendance à la solitude choisie n'a pas d'influence positive sur le sentiment de solitude subie. Toutefois, l'étude est limitée. Elle a principalement interrogé de jeunes adultes d'origine latino-américaine vivant dans le sud du Texas, sur la base d'informations fournies par eux- mêmes. Elle n'a pas abordé les éventuelles difficultés rencontrées pendant l'enfance. D'autres résultats de recherche montrent un paradoxe de la solitude : la tendance à être seules n'améliore pas le bien-être des personnes qui ne sont pas en bonne santé psychique. En d'autres termes, être seul ne peut être éventuellement perçu comme un soulagement que par les personnes en bonne santé psychique. Pour les autres, c’est une stress.Douleur et qualité de vie : hypersensibilité et sensibilisation
centrale chez les patients souffrant de douleurs chroniques
Dr Veronique de Gucht, de l'université de Leyde (Pays-Bas), étudie actuellement les liens entre la douleur nociplastique (HACS - « Human Assumed Central Sensitisation » ou « nociplastic pain ») et la qualité de vie des personnes hypersensibles. Qu'est-ce que la douleur nociplastique ? Certains patients souffrant de douleurs chroniques développent à long terme un système de douleur si sensible que même des stimuli a priori non douloureux provoquent une douleur excessive. Il peut également arriver que la seule possibilité de ressentir une douleur future entraîne des anticipations exagérées du niveau de douleur (« catastrophisme douloureux » ou « pain catastrophising »), des ruminations et un sentiment d'impuissance. La difficulté dans la recherche réside dans le fait que la perception de la douleur est toujours subjective et ne peut être mesurée objectivement. Divers questionnaires spécialisés ont été développés à cet effet : • Central Sensitization Inventory (CSI), • Brief Pain Inventory-Short Form (BPI-SF), • pour la qualité de vie, le Short Form Health Survey-12 (SF-12v2), • et pour l'hypersensibilité, Dr de Gucht a elle-même élaboré un questionnaire, le Sensory Processing Sensitivity Questionnaire (SPSQ – www.sps-q.com). On tente de rendre la mesure de la douleur un peu plus objective, par exemple par le test de l'eau froide. (Ce test consiste à plonger une extrémité corporelle dans de l'eau froide et à mesurer les effets physiologiques sur le cœur et la circulation sanguine.) De l'étude actuelle, il est ressorti une question-clef par les effets que sa réponse produit sur le ressenti de la douleur : comment les personnes perçoivent-elles et évaluent-elles fondamentalement leur hypersensibilité – comme un bienfait ou comme un fardeau ? • Chez les personnes qui vivent leur hypersensibilité plutôt négativement, la douleur nociplastique et en particulier l'anticipation de la douleur étaient plus marquées que chez les personnes normalement sensibles. • En revanche, une hypersensibilité positive peut même réduire l'anticipation de la douleur par rapport aux autres personnes ! Du coup, la douleur est moins forte lorsqu’elle survient. Il apparaît qu'un enchaînement menant de l'anticipation de la douleur à la qualité de vie joue ici un rôle central : 1. une hypersensibilité vécue de manière positive et acceptée conduit à une anticipation de la douleur moindre. 2. Une anticipation de la douleur moindre réduit à son tour la douleur nociplastique. 3. Cette douleur moindre entraîne une meilleure qualité de vie. Il en résulte des pistes d'intervention. Les thérapies devraient notamment traiter conjointement les deux domaines : • le domaine cognitif (anticipation de la douleur) • et le domaine physiologique (douleur). Il est encore difficile de donner des recommandations générales aux patients souffrant de douleurs afin de réduire leur anticipation de la douleur et d'influencer ainsi leur qualité de vie. Cependant, les techniques de pleine conscience sont de plus en plus utilisées dans les cliniques de la douleur. De futures recherches pourraient porter sur d'autres facteurs tels que le type et la durée de la douleur et les formes de traitement.Le rôle de la sensibilité environnementale dans la croissance
post-traumatique et la gestion du stress
Maria Jernslett est doctorante à l'université d'Édimbourg en Écosse et s'intéresse aux questions suivantes : comment peut-on grandir et se développer à partir d'un traumatisme ? Et quel rôle joue l'hypersensibilité dans ce processus ? La croissance post-traumatique signifie surmonter le traumatisme, l'intégrer, et grandir et mûrir grâce à lui. Les troubles de stress post-traumatique et la croissance post- traumatique ne s'excluent pas mutuellement. Une méta-analyse a montré que les deux peuvent tout à fait se produire en parallèle ! Le plus souvent, les deux apparaissent ensemble lorsque le traumatisme est d’intensité modérée. Les facteurs qui favorisent la croissance personnelle après un traumatisme sont notamment les suivants : • intimité et liens interpersonnels, • croissance spirituelle, • le sentiment de ses propres forces, qu'il convient de développer s'il n'est pas encore présent. L'étude de Mme Jernslett a porté sur un échantillon de 302 adultes, dont la plupart ont déclaré avoir subi un traumatisme supérieur à la moyenne. La plupart étaient des femmes ayant un niveau d'éducation élevé, ce qui, selon l'auteure, limite la généralisation des résultats de l'étude. Une autre limite réside dans les distorsions cognitives qui surviennent lorsqu'on passe en revue une situation avec du recul et qu'on l’a déjà transformée en un récit cohérent et intégré dans l’histoire personnelle. Les résultats : • La croissance post-traumatique était la plus forte chez les personnes ayant une sensibilité moyenne. • Les personnes peu sensibles semblent manquer de mécanismes d'adaptation émotionnelle. • Les personnes très sensibles ont tendance à être submergées par leurs émotions, ce qui peut inhiber la croissance post-traumatique, en particulier en cas de traumatisme grave. • Un aspect particulier est ressorti de façon surprenante : une sensibilité esthétique semble aller de pair avec une croissance post-traumatique plus importante. Cependant, ce lien ne fonctionne que si l'environnement apporte un soutien ou si l'on suit une thérapie. L'environnement s'avère donc être un élément clef, car il peut agir dans un sens positif comme négatif - et il fait généralement les deux en même temps et à proportion variable. Peut-on en conclure que les personnes hypersensibles sont plus résilientes ? Le concept de résilience est trop complexe et trop général pour cela, estime Mme Jernslett. Mais si l'on se limite à la croissance personnelle, on constate là aussi que celle-ci peut être supérieure à la moyenne chez les personnes hypersensibles, mais uniquement si l'environnement est favorable et vécu comme un soutien.Discussion de clôture : Hypersensibilité et santé mentale
La partie officielle de la rencontre s'est terminée par une discussion animée par Michael Pluess avec Francesca Lionetti, Corina Greven, Tom Falkenstein, Elizabeth Roxburgh et Elena Lupo. Les personnes hypersensibles ont-elles plus souvent des problèmes de santé psychique ? Les études suggèrent un lien modéré entre les deux. Cependant, selon la professeure Corina Greven, elles isolent trop rarement la sensibilité environnementale du névrosisme (tendance aux émotions et sentiments négatifs), l'un des cinq éléments du modèle de personnalité « Big Five ». De plus, la grande majorité des études reposent sur les déclarations subjectives des participants eux-mêmes. Il est encore difficile de réaliser des mesures objectives dans ce domaine. De plus, le nombre de participants reste souvent faible dans les études. Il semble toutefois exister un lien modéré entre l'hypersensibilité et le burn-out et la dépression. Quels facteurs biologiques, neurologiques et médicaux pourraient jouer un rôle dans le lien entre l'hypersensibilité et l'augmentation des problèmes psychologiques ? Selon Dr Elizabeth Roxburgh de l'université de Canterbury, il n'existe pas encore de modèle explicatif valable. L'un des facteurs peut être que de nombreuses personnes hypersensibles ne se sentent pas acceptées pendant leur enfance et leur adolescence, ce qui pourrait durablement augmenter leur vulnérabilité psychologique au-delà de la jeunesse. Les attentes et les normes sociales ainsi que diverses formes de discrimination jouent également un rôle. Le burn-out peut être dû à une charge de travail élevée, mais il existe également un épuisement lié à un excès de compassion et d'empathie ! Dans ce cas, on ne s'est pas suffisamment protégé et on se retrouve en burn-out empathique. Les traitements psychothérapeutiques doivent-ils être spécifiquement adaptés aux personnes hypersensibles ? Tom Falkenstein est un psychothérapeute allemand exerçant en Angleterre. Il pense que les interventions adaptées à une souffrance particulière peuvent être appliquées à tous et ne doivent pas être spécialement adaptées aux personnes hypersensibles. Cela étant dit, il reçoit régulièrement des demandes de personnes hypersensibles qui ont suivi différentes thérapies, en ont été insatisfaites et recherchent désormais quelqu'un qui soit familiarisé avec les spécificités de l'hypersensibilité. Le facteur clef le plus important pour la guérison est peut-être la relation thérapeutique. Une bonne compréhension de l'hypersensibilité est certainement utile pour établir une relation de qualité. On peut donc dire que les thérapeutes doivent toujours garder à l'esprit l'hypersensibilité de leurs patients, mais à part cela, ils peuvent utiliser les mêmes interventions que pour les autres patients. Les personnes hypersensibles sont-elles plus faciles à traiter en psychothérapie ? D'après l'expérience de M. Falkenstein, la relation thérapeutique avec les personnes hypersensibles est souvent plus profonde. Il se pourrait que cela favorise également le succès du traitement. Acceptation culturelle de l'hypersensibilité : quelles sont les différences entre les pays ? Dr Elizabeth Roxburgh a mené des enquêtes auprès d'étudiants dans différents pays. Il en ressort que les personnes hypersensibles en Chine se sentent mieux dans leur vie que la moyenne. A l’opposé, au Royaume-Uni, le bien-être des étudiants hypersensibles est inférieur à la moyenne. Elena Lupo a quitté son cabinet en Italie pour devenir coach et conseillère afin d'échapper aux restrictions institutionnelles en matière de traitement. Elle a fondé sa propre association et forme aujourd'hui des thérapeutes. Elle remarque que beaucoup de gens considèrent encore l'hypersensibilité comme une mode New Age, une coquetterie, une excuse pour justifier le suicide chez les jeunes ou encore comme un autre nom pour désigner un léger autisme. Tom Falkenstein constate un changement en Allemagne au cours des dix dernières années. Le thème de l'hypersensibilité est mieux accepté. Mais les financements alloués à la recherche idoine restent encore très limités. Elizabeth Roxburgh constate qu'il n'existe actuellement aucun programme de formation continue sur la sensibilité environnementale au Royaume-Uni, alors que ce serait bien utile. Existe-t-il un lien entre l’hypersensibilité et le TDA(H) ou l'autisme ? Cette question revient très souvent. La professeure Corina Greven vient du domaine de la recherche sur le TDA(H) et a également des liens étroits avec la recherche sur l'autisme. Dans l’état actuel de la recherche, les études ne semblent pas confirmer de lien entre les deux. Certaines études montrent une légère corrélation, mais celle-ci n'est pas confirmée. La qualité de ces études est généralement faible : elles portent sur un petit nombre de personnes et, au lieu de diagnostics cliniques confirmés, reposent très souvent sur les déclarations subjectives des participants. De plus, même s'il existait une corrélation statistique, cela ne signifierait pas encore grand-chose, en particulier en ce qui concerne les causes profondes. Quel rôle la prévention joue-t-elle dans le bien-être des personnes hypersensibles ? De nombreux points ont déjà été abordés plus haut, notamment par Dr Black. Dr Roxburgh identifie notamment des facteurs tels que le lien avec la nature, un bon équilibre entre sociabilité et périodes de solitude, et le développement personnel (par exemple, tenir un journal de gratitude, dont les effets positifs semblent avérés). Les relations authentiques et proches sont également importantes. Les personnes hypersensibles ont davantage tendance à souffrir de solitude émotionnelle que sociale. Si les relations sont trop superficielles, les personnes hypersensibles peuvent se sentir plus seules en étant avec les autres qu’en étant seules. Les techniques de respiration, les activités créatives et l'acceptation de soi sont également bénéfiques. En outre, tout le monde, les hypersensibles en premier, peut contribuer à sensibiliser la société à l'hypersensibilité et faire le pas d’entrer en contact avec d'autres personnes hypersensibles dans sa région. L'hypersensibilité peut-elle également avoir un effet positif sur la santé mentale ? Tom Falkenstein aide toujours ses patients hypersensibles à réinterpréter les situations sous un autre angle (technique du « reframing »). Il utilise par ailleurs la psychoéducation pour les aider à mieux se comprendre et à prendre conscience des ressources que leur hypersensibilité leur apporte. Elena Lupo constate une très grande différence en matière de santé psychique entre les personnes hypersensibles qui cherchent de l'aide et celles qui ne le font pas. Le soutien et les conseils pour gérer l'hypersensibilité et accroître l'efficacité personnelle sont très utiles à cet égard. Il est également important pour les personnes hypersensibles de se connecter à des tâches ou des objectifs plus élevés, au-delà de l’individuel, voire à un grand tout, éventuellement au plan spirituel. Il est également important pour les personnes hypersensibles de sortir de leur tête. En règle générale, elles pensent trop. Il faut mieux unifier la pensée et les sentiments. Les interventions corporelles sont utiles à cet égard. La technique du Somatic Experiencing en est un exemple. Y a-t-il un lien entre l'hypersensibilité et introversion ou extraversion ? La répartition entre l'introversion et l'extraversion chez les hypersensibles ne semble pas différente de la population générale. Si l'on considère les cinq composantes du modèle de personnalité « Big Five » ou « OCEAN » (qui comprend également l'extraversion/introversion), l'hypersensibilité est plutôt corrélée aux composantes névrosisme et ouverture à la nouveauté. Vous trouverez des informations sur les nouvelles études scientifiques et les prochains événements de recherche sur le réseau Sensitivity Research. Cliquez ici pour revenir à la première partie Lire aussi : • Sommet 2024 sur la recherche en matière d'hypersensibilité (disponible uniquement en alllemand) • Coaching pour hypersensibles • L'hypersensibilité au travail et dans le management • Le côté obscur de l'hypersensibilité • Autres articles et blogs • Déroulement d'une première séance de coaching • Contact et prise de rendez-vousAlexander Hohmann - le Blog
Le coaching, la vie et le reste
Courriel:
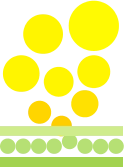
Contenu de la seconde partie
(Première partie : cliquez ici pour accéder à la partie 1) • Comment le repos et le sommeil agissent-ils sur la mémoire des personnes hypersensibles ? • Quels sont les facteurs qui permettent aux hypersensibles de trouver une meilleure qualité de vie ? • Influence de la solitude choisie ou subie sur le lien entre hypersensibilité et santé • Douleur et qualité de vie : hypersensibilité et sensibilisation centrale (HACS) chez les patients souffrant de douleurs chroniques • Le rôle de l’hypersensibilité dans la croissance post-traumatique et la gestion du stress • Discussion sur les liens entre hypersensibilité et santé mentale : questions et réponses sur les facteurs positifs et négatifs influant sur la santé mentale, prévention et hypersensibilité, les particularités de la psychothérapie avec des HSP, les liens avec d'autres formes de neurodiversité, l'acceptation culturelle, les différences entre les pays, etc.Comment le repos et le sommeil
affectent-ils la mémoire des
personnes hypersensibles ?
Dr Robert Marhenke, de l'université d'Innsbruck, étudie l'influence du repos à l’état de veille et du sommeil sur la mémoire. Dans l’une des expérimentations, les participants ont été répartis en deux groupes. Pour commencer, les deux groupes devaient mémoriser deux listes de mots. • Un groupe a ensuite pu se reposer les yeux fermés pendant 8 minutes. • L'autre groupe devait accomplir pendant 8 minutes des tâches qui exigeaient une attention visuelle. • Une semaine plus tard, on leur a demandé de quels mots mémorisés ils se souvenaient. • Chez les non-hypersensibles, aucune différence n'a été constatée entre les deux groupes. • Parmi les hypersensibles, le groupe qui avait fait une pause de 8 minutes les yeux fermés se souvenait de nettement plus de mots que la moyenne, tandis que les hypersensibles de l'autre groupe se souvenaient de nettement moins de mots que la moyenne. • Cette différence chez les personnes hypersensibles n'est toutefois pas apparue lorsqu’elles étaient interrogées immédiatement après l'expérience, mais seulement lors d'un questionnaire réalisé plusieurs jours plus tard ! Il était également intéressant de noter que pendant la pause, les personnes hypersensibles présentaient des connexions plus denses dans les ondes cérébrales au sein du réseau du mode par défaut (« Default Mode Network ») et plus particulièrement entre l'hippocampe et le précuneus. Cela pourrait indiquer un mécanisme de « consolidation du système », dans lequel les souvenirs, qui se trouvent généralement dans l'hippocampe, sont transférés vers le néocortex pour être stockés à long terme. De tels mécanismes peuvent se produire dans un état de veille au calme, mais ils sont surtout typiques de la phase dite paradoxale du sommeil. Ils peuvent signifier une mémoire à long terme accrue – ou alors un traitement plus profond des expériences vécues. Une autre expérience menée avec des utilisateurs d'Instagram a comparé l'effet de 8 minutes de pause yeux fermés à 8 minutes de navigation sur Instagram. Ici, les utilisateurs d'Instagram hypersensibles ont montré les performances mémorielles les plus basses de tous lorsqu'on leur a demandé de se souvenir des mots 16 et 35 minutes après l'exercice. D'autres études semblent montrer que cette meilleure mémoire chez les personnes hypersensibles n'est efficace que si la pause est prise immédiatement après l'apprentissage. En revanche, aucune différence n'est constatée lorsque les pauses sont prises plus tard ou après avoir dormi. Il en ressort que les personnes hypersensibles ont une meilleure mémoire lorsqu'elles font une pause immédiatement après une nouvelle expérience, afin de l'assimiler. Si elles attendent, cet avantage disparaît.Quels sont les facteurs qui
permettent aux personnes
hypersensibles d’atteindre une
meilleure qualité de vie ? Un
état des lieux des
connaissances pour plus de
bien-être
Dr Becky Black de l'université de Melbourne et Dr Rohan Borschmann de l'université d'Oxford mènent une étude continue de la littérature spécialisée de 1990 à aujourd'hui. Ils recherchent tous les facteurs susceptibles d'améliorer le bien-être des personnes hypersensibles. Ces facteurs et stratégies ont probablement un effet positif sur tout le monde. Mais l’effet semble être plus intensément bénéfique sur les personnes hypersensibles. • Facteurs environnementaux : parents attentifs et encourageants, transitions bien vécues entre les étapes du parcours scolaire, environnement de travail favorable. • Lien à la nature : une immersion dans la nature réduit notamment les ruminations et améliore l'humeur. Même de courts séjours dans la nature ont un effet positif. Les forêts ont un effet positif plus marqué que les champs. • Stratégies psychologiques : pleine conscience, méditation, acceptation de soi, pensée positive, autorégulation émotionnelle – en particulier discuter consciemment des situations avec soi-même afin de les voir sous un autre angle, de les évaluer de manière plus rationnelle et de les relativiser («réévaluation cognitive» / «cognitive reappraisal»). • Réseau humain personnel et relations : échanger ses expériences avec d'autres hypersensibles apporte une validation ; le développement des compétences interpersonnelles est particulièrement important pour prévenir la dépression chez les jeunes ; un bon équilibre entre sociabilité et moments tout seuls ; le sentiment d'être soutenu par son entourage et sa famille. • Activités physiques : yoga et méditation, activité physique et sport réguliers, alimentation saine, routines et structures. • Stratégies d'adaptation : environnement calme, casques ou écouteurs à suppression de bruits, exprimer ses émotions, demander soutien et d'aide, résoudre les des problèmes et planifier, éviter des stimuli excessifs. • Développement personnel : connaissance de soi, en particulier connaissance de l'hypersensibilité, développer son intelligence émotionnelle, rechercher un sens et un but à la vie. • Aide professionnelle : psychothérapie de qualité avec des thérapeutes familiarisés avec l'hypersensibilité, interventions sur mesure (par exemple, les enfants hypersensibles réagissent mieux à une thérapie individuelle qu'à une thérapie de groupe), programmes visant à renforcer la résilience. • Profession et carrière : trouver une carrière qui correspond à l'hypersensibilité, dans un environnement qui permet l'autonomie et pratique des styles de management qui soutient les salariés. En conclusion, on constate l'importance à la fois d'un environnement adapté et des stratégies personnelles. Des recherches futures pourraient examiner l'effet spécifique de certaines interventions psychologiques ou thérapeutiques individuelles.Influence de la solitude choisie
ou subie sur le lien entre
hypersensibilité et santé
Dr Grant Benham, de l'université du Texas dans la vallée du Rio Grande, étudie comment les défis dans les relations aux autres affectent la santé des personnes hypersensibles. Voici quelques exemples de ces défis : • déficits en matière de compétences interpersonnelles et communicatives, • phobie sociale, • relations superficielles, • absence de relations positives. (L'introversion ou la timidité ne sont pas ici considérées parmi ces défis.) Il faut garder à l'esprit qu'une faible sociabilité peut également être une stratégie librement choisie pour faire face à une trop forte réponse aux stimuli. Le Dr Benham a publié sa première étude sur le lien entre hypersensibilité et santé en 2006, qui portait alors sur les symptômes physiques. Depuis lors, différentes études ont été menées sur le lien entre l'hypersensibilité et les problèmes de santé tant physique que mentale. Les personnes hypersensibles ont une tendance plus marquée à passer volontairement du temps seules. Il convient toutefois de distinguer la solitude choisie (anglais : « solitude ») de la solitude subie (anglais : « loneliness »), cette dernière povant être perçue comme un stress. Le Dr Benham s'est notamment posé la question suivante : les personnes hypersensibles sont- elles plus souvent seules ? Ou le fait de choisir d'être seul réduit-il au contraire le sentiment de solitude ? Les résultats ont montré que les personnes hypersensibles ont effectivement plus souvent que les autres des sentiments de solitude, et que la tendance à la solitude choisie n'a pas d'influence positive sur le sentiment de solitude subie. Toutefois, l'étude est limitée. Elle a principalement interrogé de jeunes adultes d'origine latino-américaine vivant dans le sud du Texas, sur la base d'informations fournies par eux-mêmes. Elle n'a pas abordé les éventuelles difficultés rencontrées pendant l'enfance. D'autres résultats de recherche montrent un paradoxe de la solitude : la tendance à être seules n'améliore pas le bien-être des personnes qui ne sont pas en bonne santé psychique. En d'autres termes, être seul ne peut être éventuellement perçu comme un soulagement que par les personnes en bonne santé psychique. Pour les autres, c’est une stress.Douleur et qualité de vie :
hypersensibilité et
sensibilisation centrale chez les
patients souffrant de douleurs
chroniques
Dr Veronique de Gucht, de l'université de Leyde (Pays-Bas), étudie actuellement les liens entre la douleur nociplastique (HACS - « Human Assumed Central Sensitisation » ou « nociplastic pain ») et la qualité de vie des personnes hypersensibles. Qu'est-ce que la douleur nociplastique ? Certains patients souffrant de douleurs chroniques développent à long terme un système de douleur si sensible que même des stimuli a priori non douloureux provoquent une douleur excessive. Il peut également arriver que la seule possibilité de ressentir une douleur future entraîne des anticipations exagérées du niveau de douleur (« catastrophisme douloureux » ou « pain catastrophising »), des ruminations et un sentiment d'impuissance. La difficulté dans la recherche réside dans le fait que la perception de la douleur est toujours subjective et ne peut être mesurée objectivement. Divers questionnaires spécialisés ont été développés à cet effet : • Central Sensitization Inventory (CSI), • Brief Pain Inventory-Short Form (BPI-SF), • pour la qualité de vie, le Short Form Health Survey-12 (SF-12v2), • et pour l'hypersensibilité, Dr de Gucht a elle- même élaboré un questionnaire, le Sensory Processing Sensitivity Questionnaire (SPSQ – www.sps-q.com). On tente de rendre la mesure de la douleur un peu plus objective, par exemple par le test de l'eau froide. (Ce test consiste à plonger une extrémité corporelle dans de l'eau froide et à mesurer les effets physiologiques sur le cœur et la circulation sanguine.) De l'étude actuelle, il est ressorti une question-clef par les effets que sa réponse produit sur le ressenti de la douleur : comment les personnes perçoivent-elles et évaluent-elles fondamentalement leur hypersensibilité – comme un bienfait ou comme un fardeau ? • Chez les personnes qui vivent leur hypersensibilité plutôt négativement, la douleur nociplastique et en particulier l'anticipation de la douleur étaient plus marquées que chez les personnes normalement sensibles. • En revanche, une hypersensibilité positive peut même réduire l'anticipation de la douleur par rapport aux autres personnes ! Du coup, la douleur est moins forte lorsqu’elle survient. Il apparaît qu'un enchaînement menant de l'anticipation de la douleur à la qualité de vie joue ici un rôle central : 1. une hypersensibilité vécue de manière positive et acceptée conduit à une anticipation de la douleur moindre. 2. Une anticipation de la douleur moindre réduit à son tour la douleur nociplastique. 3. Cette douleur moindre entraîne une meilleure qualité de vie. Il en résulte des pistes d'intervention. Les thérapies devraient notamment traiter conjointement les deux domaines : • le domaine cognitif (anticipation de la douleur) • et le domaine physiologique (douleur). Il est encore difficile de donner des recommandations générales aux patients souffrant de douleurs afin de réduire leur anticipation de la douleur et d'influencer ainsi leur qualité de vie. Cependant, les techniques de pleine conscience sont de plus en plus utilisées dans les cliniques de la douleur. De futures recherches pourraient porter sur d'autres facteurs tels que le type et la durée de la douleur et les formes de traitement.Le rôle de la sensibilité
environnementale dans la
croissance post-traumatique et
la gestion du stress
Maria Jernslett est doctorante à l'université d'Édimbourg en Écosse et s'intéresse aux questions suivantes : comment peut-on grandir et se développer à partir d'un traumatisme ? Et quel rôle joue l'hypersensibilité dans ce processus ? La croissance post-traumatique signifie surmonter le traumatisme, l'intégrer, et grandir et mûrir grâce à lui. Les troubles de stress post- traumatique et la croissance post- traumatique ne s'excluent pas mutuellement. Une méta-analyse a montré que les deux peuvent tout à fait se produire en parallèle ! Le plus souvent, les deux apparaissent ensemble lorsque le traumatisme est d’intensité modérée. Les facteurs qui favorisent la croissance personnelle après un traumatisme sont notamment les suivants : • intimité et liens interpersonnels, • croissance spirituelle, • le sentiment de ses propres forces, qu'il convient de développer s'il n'est pas encore présent. L'étude de Mme Jernslett a porté sur un échantillon de 302 adultes, dont la plupart ont déclaré avoir subi un traumatisme supérieur à la moyenne. La plupart étaient des femmes ayant un niveau d'éducation élevé, ce qui, selon l'auteure, limite la généralisation des résultats de l'étude. Une autre limite réside dans les distorsions cognitives qui surviennent lorsqu'on passe en revue une situation avec du recul et qu'on l’a déjà transformée en un récit cohérent et intégré dans l’histoire personnelle. Les résultats : • La croissance post-traumatique était la plus forte chez les personnes ayant une sensibilité moyenne. • Les personnes peu sensibles semblent manquer de mécanismes d'adaptation émotionnelle. • Les personnes très sensibles ont tendance à être submergées par leurs émotions, ce qui peut inhiber la croissance post-traumatique, en particulier en cas de traumatisme grave. • Un aspect particulier est ressorti de façon surprenante : une sensibilité esthétique semble aller de pair avec une croissance post-traumatique plus importante. Cependant, ce lien ne fonctionne que si l'environnement apporte un soutien ou si l'on suit une thérapie. L'environnement s'avère donc être un élément clef, car il peut agir dans un sens positif comme négatif - et il fait généralement les deux en même temps et à proportion variable. Peut-on en conclure que les personnes hypersensibles sont plus résilientes ? Le concept de résilience est trop complexe et trop général pour cela, estime Mme Jernslett. Mais si l'on se limite à la croissance personnelle, on constate là aussi que celle-ci peut être supérieure à la moyenne chez les personnes hypersensibles, mais uniquement si l'environnement est favorable et vécu comme un soutien.Discussion de clôture :
Hypersensibilité et santé
mentale
La partie officielle de la rencontre s'est terminée par une discussion animée par Michael Pluess avec Francesca Lionetti, Corina Greven, Tom Falkenstein, Elizabeth Roxburgh et Elena Lupo. Les personnes hypersensibles ont-elles plus souvent des problèmes de santé psychique ? Les études suggèrent un lien modéré entre les deux. Cependant, selon la professeure Corina Greven, elles isolent trop rarement la sensibilité environnementale du névrosisme (tendance aux émotions et sentiments négatifs), l'un des cinq éléments du modèle de personnalité « Big Five ». De plus, la grande majorité des études reposent sur les déclarations subjectives des participants eux-mêmes. Il est encore difficile de réaliser des mesures objectives dans ce domaine. De plus, le nombre de participants reste souvent faible dans les études. Il semble toutefois exister un lien modéré entre l'hypersensibilité et le burn-out et la dépression. Quels facteurs biologiques, neurologiques et médicaux pourraient jouer un rôle dans le lien entre l'hypersensibilité et l'augmentation des problèmes psychologiques ? Selon Dr Elizabeth Roxburgh de l'université de Canterbury, il n'existe pas encore de modèle explicatif valable. L'un des facteurs peut être que de nombreuses personnes hypersensibles ne se sentent pas acceptées pendant leur enfance et leur adolescence, ce qui pourrait durablement augmenter leur vulnérabilité psychologique au- delà de la jeunesse. Les attentes et les normes sociales ainsi que diverses formes de discrimination jouent également un rôle. Le burn-out peut être dû à une charge de travail élevée, mais il existe également un épuisement lié à un excès de compassion et d'empathie ! Dans ce cas, on ne s'est pas suffisamment protégé et on se retrouve en burn-out empathique. Les traitements psychothérapeutiques doivent-ils être spécifiquement adaptés aux personnes hypersensibles ? Tom Falkenstein est un psychothérapeute allemand exerçant en Angleterre. Il pense que les interventions adaptées à une souffrance particulière peuvent être appliquées à tous et ne doivent pas être spécialement adaptées aux personnes hypersensibles. Cela étant dit, il reçoit régulièrement des demandes de personnes hypersensibles qui ont suivi différentes thérapies, en ont été insatisfaites et recherchent désormais quelqu'un qui soit familiarisé avec les spécificités de l'hypersensibilité. Le facteur clef le plus important pour la guérison est peut-être la relation thérapeutique. Une bonne compréhension de l'hypersensibilité est certainement utile pour établir une relation de qualité. On peut donc dire que les thérapeutes doivent toujours garder à l'esprit l'hypersensibilité de leurs patients, mais à part cela, ils peuvent utiliser les mêmes interventions que pour les autres patients. Les personnes hypersensibles sont-elles plus faciles à traiter en psychothérapie ? D'après l'expérience de M. Falkenstein, la relation thérapeutique avec les personnes hypersensibles est souvent plus profonde. Il se pourrait que cela favorise également le succès du traitement. Acceptation culturelle de l'hypersensibilité : quelles sont les différences entre les pays ? Dr Elizabeth Roxburgh a mené des enquêtes auprès d'étudiants dans différents pays. Il en ressort que les personnes hypersensibles en Chine se sentent mieux dans leur vie que la moyenne. A l’opposé, au Royaume-Uni, le bien- être des étudiants hypersensibles est inférieur à la moyenne. Elena Lupo a quitté son cabinet en Italie pour devenir coach et conseillère afin d'échapper aux restrictions institutionnelles en matière de traitement. Elle a fondé sa propre association et forme aujourd'hui des thérapeutes. Elle remarque que beaucoup de gens considèrent encore l'hypersensibilité comme une mode New Age, une coquetterie, une excuse pour justifier le suicide chez les jeunes ou encore comme un autre nom pour désigner un léger autisme. Tom Falkenstein constate un changement en Allemagne au cours des dix dernières années. Le thème de l'hypersensibilité est mieux accepté. Mais les financements alloués à la recherche idoine restent encore très limités. Elizabeth Roxburgh constate qu'il n'existe actuellement aucun programme de formation continue sur la sensibilité environnementale au Royaume-Uni, alors que ce serait bien utile. Existe-t-il un lien entre l’hypersensibilité et le TDA(H) ou l'autisme ? Cette question revient très souvent. La professeure Corina Greven vient du domaine de la recherche sur le TDA(H) et a également des liens étroits avec la recherche sur l'autisme. Dans l’état actuel de la recherche, les études ne semblent pas confirmer de lien entre les deux. Certaines études montrent une légère corrélation, mais celle-ci n'est pas confirmée. La qualité de ces études est généralement faible : elles portent sur un petit nombre de personnes et, au lieu de diagnostics cliniques confirmés, reposent très souvent sur les déclarations subjectives des participants. De plus, même s'il existait une corrélation statistique, cela ne signifierait pas encore grand-chose, en particulier en ce qui concerne les causes profondes. Quel rôle la prévention joue-t-elle dans le bien-être des personnes hypersensibles ? De nombreux points ont déjà été abordés plus haut, notamment par Dr Black. Dr Roxburgh identifie notamment des facteurs tels que le lien avec la nature, un bon équilibre entre sociabilité et périodes de solitude, et le développement personnel (par exemple, tenir un journal de gratitude, dont les effets positifs semblent avérés). Les relations authentiques et proches sont également importantes. Les personnes hypersensibles ont davantage tendance à souffrir de solitude émotionnelle que sociale. Si les relations sont trop superficielles, les personnes hypersensibles peuvent se sentir plus seules en étant avec les autres qu’en étant seules. Les techniques de respiration, les activités créatives et l'acceptation de soi sont également bénéfiques. En outre, tout le monde, les hypersensibles en premier, peut contribuer à sensibiliser la société à l'hypersensibilité et faire le pas d’entrer en contact avec d'autres personnes hypersensibles dans sa région. L'hypersensibilité peut-elle également avoir un effet positif sur la santé mentale ? Tom Falkenstein aide toujours ses patients hypersensibles à réinterpréter les situations sous un autre angle (technique du « reframing »). Il utilise par ailleurs la psychoéducation pour les aider à mieux se comprendre et à prendre conscience des ressources que leur hypersensibilité leur apporte. Elena Lupo constate une très grande différence en matière de santé psychique entre les personnes hypersensibles qui cherchent de l'aide et celles qui ne le font pas. Le soutien et les conseils pour gérer l'hypersensibilité et accroître l'efficacité personnelle sont très utiles à cet égard. Il est également important pour les personnes hypersensibles de se connecter à des tâches ou des objectifs plus élevés, au-delà de l’individuel, voire à un grand tout, éventuellement au plan spirituel. Il est également important pour les personnes hypersensibles de sortir de leur tête. En règle générale, elles pensent trop. Il faut mieux unifier la pensée et les sentiments. Les interventions corporelles sont utiles à cet égard. La technique du Somatic Experiencing en est un exemple. Y a-t-il un lien entre l'hypersensibilité et introversion ou extraversion ? La répartition entre l'introversion et l'extraversion chez les hypersensibles ne semble pas différente de la population générale. Si l'on considère les cinq composantes du modèle de personnalité « Big Five » ou « OCEAN » (qui comprend également l'extraversion/introversion), l'hypersensibilité est plutôt corrélée aux composantes névrosisme et ouverture à la nouveauté. Vous trouverez des informations sur les nouvelles études scientifiques et les prochains événements de recherche sur le réseau Sensitivity Research. Cliquez ici pour revenir à la première partie Lire aussi : • Sommet 2024 sur la recherche en matière d'hypersensibilité (disponible uniquement en alllemand) • Coaching pour hypersensibles • L'hypersensibilité au travail et dans le management • Le côté obscur de l'hypersensibilité • Autres articles et blogs • Déroulement d'une première séance de coaching • Contact et prise de rendez-vousAlexander Hohmann
Le Blog
Le coaching, la vie et le reste

- Contact et prise de rendez-vous
- De nouvelles voies avec un coach
- Hypersensibilité
- Hypersensibilité en entreprise
- Haut potentiel intellectuel
- Petite biographie du coach
- Le "coaching systémique", qu'est-ce?
- Que disent les clients?
- Blog & Articles
- Podcasts, Vidéos, Médias
- Ressources & Liens
- Mentions légales
- RETOUR